Mon entretien pour la revue Esprit du mois de juin 2021 : l’impossible décentralisation
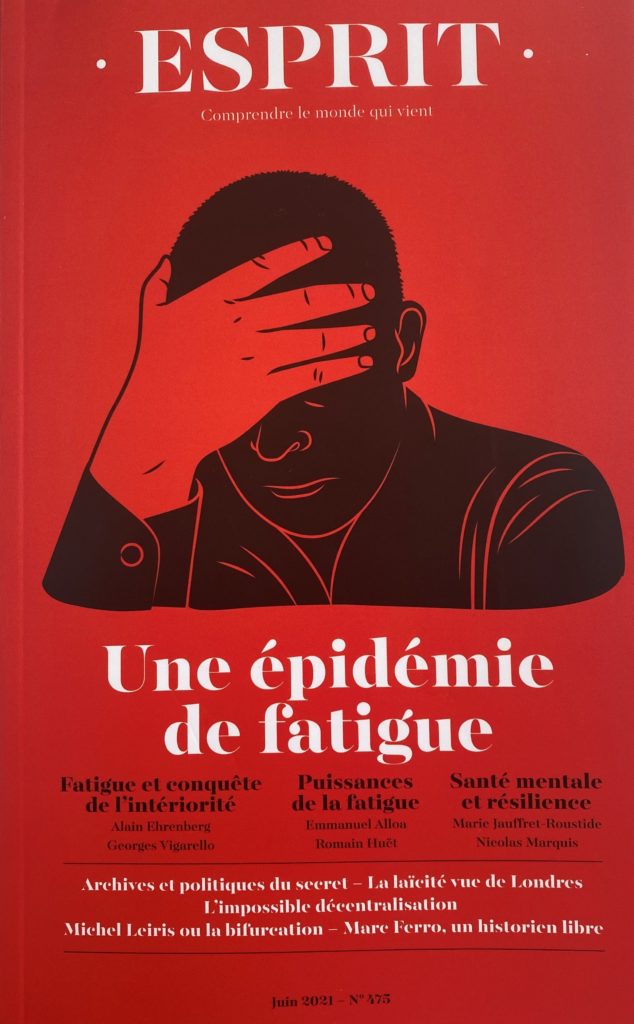
Esprit – En tant que maire, vous êtes aux premières loges de la relation entre l’État et les collectivités locales. Comment voyez-vous les principales évolutions dans ce domaine ? Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, qu’avons-nous appris ? Qu’est-ce la crise sanitaire a confirmé, révélé ou infirmé ?
Philippe Laurent – On parle constamment de l’État en France, sans toujours savoir de quoi on parle. Bien souvent on désigne à travers l’État ce qui relève plus largement des pouvoirs publics, ce qui est source de confusion : les collectivités locales sont-elles des prolongements de l’État ou des acteurs publics autonomes qui doivent travailler en partenariat avec l’État ? Ont-elles une source d’autonomie ou non ? L’évolution de nos conceptions à ce sujet a été très lente. Mitterrand disait que la France a eu besoin d’un pouvoir fort et centralisé pour se faire, et qu’elle a aujourd’hui besoin d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire.
Une première rupture dans notre histoire centralisatrice contemporaine intervient avec la loi Defferre du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (il y a derrière quatre-vingt textes de mise en œuvre, c’est une construction législative énorme). Se dégage de cette affaire une vision éminemment politique. Mauroy et Defferre sont allés très vite, car Mitterrand se serait sans doute accomodé d’un fonctionnement centralisé du pouvoir. Cela lui a été possible grâce aux premières avancées décentralisatrices réalisées sous Giscard. Ce fut d’ailleurs le seul acte décentralisateur de la période.
À partir de ce moment et jusqu’aux années 2000, un grand vent de confiance s’installe entre l’État et les collectivités grâce à ce transfert de pouvoir. Un autre texte important a été la loi Chevènement de 1999, qui donne des outils aux communes pour créer des intercommunalités choisies. Le deuxième acte de la décentralisation, en 2003-2004, porté par Jean-Pierre Raffarin, a en revanche plutôt échoué. Mais c’est la crise financière de 2008 qui marque une rupture de confiance : une partie de l’État a décidé de s’attaquer aux collectivités, des collectivités qui ne présentaient pas un front assez fort pour résister. L’élection de François Hollande a suscité un regain d’espoir chez les élus locaux. La désillusion a été violente puisqu’il y a eu une reprise en main forte par l’administration centrale, qui s’est encore accrue depuis. Dorénavant, dans la relation entre les collectivités locales et l’État (on parle surtout de l’administration), c’est la question financière qui prévaut. La loi Defferre n’est pas allée au bout de la logique sur ce plan.
Aujourd’hui, la crise sanitaire a rendu manifestes nombre de problèmes et de contradictions dans les relations entre État et collectivités. Paradoxalement, notre culture très centralisatrice n’a pas empêché l’État de produire un discours confus, ni sa stratégie de fluctuer sans cesse. Et bien souvent, c’est la figure du maire qui s’est retrouvée en première ligne. A Sceaux, suite à l’annonce du premier confinement, j’ai dû convoquer le mardi 17 mars au matin les principaux cadres de la mairie pour mettre à jour notre plan de fonctionnement. Malgré mon jugement par moments sévère à l’égard de l’État, ses cadres locaux ont pu se montrer efficaces et engagés. Mais les messages et l’image nationale ont parfois été catastrophiques. Lorsque, début avril 2020, j’ai pris un arrêté pour obliger le port du masque à Sceaux après avoir vu la foule s’amasser dans les commerces de bouche, cet arrêté s’est trouvé attaqué par la Ligue des droits de l’homme et par le ministère de l’Intérieur, alliance peu naturelle, et annulé devant le tribunal administratif. Le Conseil d’État a ensuite confirmé cette décision, non pas au motif d’une supposée atteinte à l’intérêt général, mais parce que le juge a estimé qu’une telle mesure devait relever de l’État. Il appartient pourtant au maire de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa population. Et rappelons que l’on doit aux collectivités territoriales d’avoir équipé les Français en masques au sortir du premier confinement. Si je reconnais la compétence des préfets durant cette crise, l’État a selon moi failli sur le plan logistique, illustrant une culture où l’on croit qu’annoncer une loi ou un texte suffit à la rendre applicable et efficiente.
Esprit – Le mouvement des gilets jaunes a mis en lumière une relation forte de ces Français à leur territoire, entre demande de services publics et rejet des élites administratives ou politiques. Plus récemment, la crise sanitaire nous a également fait prendre conscience de l’importance des « bassins de vie » et des questions locales. Mais alors que se préparent les élections régionales et départementales qui devraient permettre d’en débattre, celles-ci ne semblent pas intéresser le public outre-mesure… Comment l’expliquez-vous ?
Les besoins que vous évoquez se sont en effet accrus, et une part croissante des citoyens veulent non seulement débattre de ces enjeux, mais même s’impliquer, certains pour peser dans la prise de décisions et d’autres dans l’action concrète. Selon moi cette volonté de s’impliquer nécessite un support afin de pouvoir prendre forme, il faut donc l’encourager, et la commune me semble être le meilleur échelon pour mettre en œuvre en pratique une telle volonté. Plusieurs manières d’envisager cette implication des habitants sont possibles. À Sceaux, en matière d’environnement par exemple, nous laissons les citoyens proposer leurs projets, nous proposons aux autres de voter, et nous accompagnons les projets lauréats dans leurs mises en œuvre. Nous incitons donc au décider-ensemble, mais également au faire-ensemble.
Mais si ce désir d’implication d’une partie des citoyens semble être une tendance vouée à s’inscrire sur le long terme, dans le même temps, le fonctionnement des scrutins locaux reste largement méconnu. Le principe qui consiste à élire des listes, et non des candidats, reste étranger à beaucoup. Le modèle de l’élection présidentielle, uninominal, domine largement les représentations sur ce plan. Par ailleurs, s’il existe des programmes, et pour les équipes sortantes des bilans de leur action, bien peu de gens en prennent réellement connaissance, et l’élection se focalise sur une personnalité, ou sur un ou deux points précis qui font polémique. Ainsi, dans le cadre des régionales de juin, il y a plus à attendre des quelques débats qui auront lieu dans les médias pour susciter l’intérêt sur les enjeux du scrutin, que de la consultation des programmes.
Dans le débat public actuel, la question sécuritaire paraît centrale. Sur ce sujet, quelle est mais aussi quelle pourrait être l’articulation entre l’État et les collectivités ? On déplore souvent la disparition de la police de proximité. Qu’en est-il de la police municipale ? Les exécutifs locaux se positionnent-ils fortement sur ces sujets ?
Pour commencer je rappelle qu’en France, le maire est à la fois le représentant de l’État et celui de l’autorité municipale, une situation qui contraste avec la plupart des autres pays. Voilà pourquoi le maire organise des élections ou agit en qualité d’officier d’état civil, ce qui suppose une compétence d’État. Donc en ce qui concerne votre question relative à l’ordre, le maire devrait disposer des moyens de l’État puisqu’il le représente. Le maire devrait par exemple pouvoir définir avec le préfet la doctrine d’emploi de la police nationale sur son territoire. Or, il n’existe aucun dialogue de ce genre avec le préfet.
Si les élus locaux financent leur police, cela suppose d’emblée des moyens locaux suffisants en même temps que cela implique un choix politique au détriment d’autres mesures, mais le principal enjeu reste de savoir si la responsabilité de la sécurité demeure aux mains de l’État ou si elle se partage. Suivant la conception républicaine unifiée que je défends, la qualité des services doit rester homogène sur l’ensemble du territoire national, et je ne peux donc que déplorer la réduction des effectifs de police nationale. Idem pour la doctrine de l’emploi orientée à mauvais escient, comme en témoigne l’usage des BAC formées pour la lutte contre la délinquance, mais que l’on dépêche dans les cortèges de manifestants. La création progressive par les maires d’une police à l’échelle de leur territoire s’est imposée à eux d’abord afin de pallier les failles de la police nationale.
Si l’on va dans ce sens, alors il faut l’exprimer de façon claire, et régler les questions de conflits de compétences qui se poseront nécessairement entre les polices, ainsi que la question de leur financement. Divers textes accordent des compétences aux polices locales de façon marginale, mais aucun texte ne s’en charge de façon globale, car, selon la Constitution, tout transfert de compétences explicite suppose un transfert financier, ce que refuse l’Etat. A mon avis nous nous dirigeons vers une confusion croissante, qui aura un effet délétère sur la sécurité en France.
Esprit – Le rapport de la France à la chose publique est inséparable de son rapport à une certaine élite administrative. Que peut-on dire du projet de suppression de l’ENA, est-il de nature à restaurer une confiance ? Du côté des collectivités, la sociologie de l’administration a-t-elle évolué ?
La fonction publique territoriale, créée en 1984, représente aujourd’hui près de deux millions d’agents en France. Elle a bien évidemment évolué ces dernières années, avec des personnels de plus en plus formés et efficaces, aux compétences techniques souvent pointues. L’enjeu consiste à leur permettre de mener leur carrière dans nos territoires. A cet égard la question de la compétence d’employeur des élus locaux est à mon avis cruciale, et ces derniers n’investissent sans doute pas suffisamment ce rôle. Car ces agents, d’un bon niveau, disposent de qualités et de formations qui leur permettent de travailler ailleurs, dans la fonction publique d’État ou dans le secteur privé. La question de leur fidélisation dans le temps se pose. Une tendance que je déplore se dessine, celle de fonctionnaires qui veulent mettre la main sur la gestion des ressources humaines sous prétexte que les élus locaux ne sauraient s’en occuper. Je souhaiterais éveiller la conscience d’employeur chez les élus, car, outre la maîtrise des financements, ils doivent détenir la maîtrise des ressources humaines, laquelle conditionne la qualité des services publics de proximité. Il s’agit en outre de stimuler les agents qui, à l’instar des habitants, tendent à développer une certaine fierté à travailler pour leur commune. Une autre tendance à surveiller est celle du passage de la fonction publique territoriale à la fonction publique d’État. La mobilité, l’existence de passerelles, tout cela est important. Mais il faut garder des personnes compétentes dans les territoires.
Pour en revenir à l’ENA, sa suppression me paraît hors du sujet, parce que le vrai problème réside à mon sens dans sa culture plus que dans son existence. Cela nécessiterait que l’on discute non des conditions d’entrée mais d’autres sujets, telles que le système de classement, ou de ce que l’on fait des jeunes recrues dans leurs premières affectations. En outre, il ne faudrait pas que la suppression de l’ENA ne se traduise par sa fusion avec l’Institution national des études territoriales (INET). L’INET doit continuer de former les cadres dont les collectivités territoriales ont besoin. Une formation et une culture communes ne garantiront pas une meilleure entente entre un préfet et un directeur général de grande ville par exemple, car cela relève d’abord des qualités humaines.
Comment voyez-vous, dans les années à venir, l’évolution des relations entre État et collectivités ? Qu’est-ce qu’il faudrait souhaiter, et construire, et que peut-on craindre ?
Je pense qu’on arrive à un point de rupture. Cette situation est liée à l’attitude de la haute administration, totalement confortée par celle de l’actuel chef de l’État. S’il n’y a pas une évolution culturelle profonde, appuyée sur de vraies réformes institutionnelles, nous nous dirigeons vers d’importantes difficultés. Si je voulais me montrer pessimiste, je vous dirais que bientôt, rien n’empêchera de remplacer nos élus locaux par de hauts fonctionnaires. Il faut prendre la mesure du fait que les collectivités sont en train de perdre leur autonomie fiscale et financière. La création de la dotation globale de fonctionnement, remplaçant les subventions ponctuelles et allouant à toutes les collectivités une enveloppe de moyens selon ses caractéristiques, date de 1979. Elle est aujourd’hui menacée. Le poids des dotations d’investissement, sur des projets précis, souvent sous l’égide du préfet de région, s’accroit. Côté fiscal, c’est d’une loi de 1980 que date la liberté de vote des taux pour les impôts locaux. Sur quatre taxes locales, il n’en reste que deux. Et comme beaucoup d’élus n’ont d’autre choix que de les augmenter dans un contexte de diminution des ressources, l’idée que ces taxes deviennent non soutenables et qu’il faut donc les supprimer, fait son chemin. C’est d’ailleurs ce que souhaite Bercy de très longue date : supprimer tous les impôts locaux pour tenir en laisse les collectivités par le biais des dotations. Nous sommes face à un délitement complet du système, contre lequel nous ne lutterons qu’à travers un changement institutionnel au plus haut niveau.
Avoir à la tête de l’État une personne concentrant autant de pouvoir, focalisant à ce point le débat public et l’attention des médias devient contre-productif et inadapté à un pays développé. Nous savons tous que le Parlement existe de moins en moins, au point que nous ne sommes plus dans un système véritablement démocratique à mon sens. Le quinquennat et l’inversion du calendrier ont considérablement accentué cette tendance. Je ne pense pas, malheureusement, que nous puissions revenir sur ce que les Français considèrent, bien à tort, comme le nec plus ultra de la démocratie, à savoir l’élection du président de la République au suffrage universel direct (dont je rappelle qu’elle ne figurait pas dans la Vème République originelle). Mais il faudrait songer à un septennat non renouvelable, ou préférer les cohabitations, où le Premier ministre, qui doit obtenir la confiance de l’Assemblée, conduit et détermine la politique de la nation, comme le veut d’ailleurs la Constitution. Cette Assemblée devrait en outre être plus représentative, en incluant une part de proportionnelle. Ce qui signifiera qu’il faudra trouver des compromis, conclure des accords. Refaire de la politique, en somme. A ce moment-là seulement, dans un jeu plus ouvert, nous retrouverons une marge de manœuvre pour les collectivités territoriales dans les politiques publiques du quotidien, de la proximité. Actuellement, et quand bien même il ne le voudrait pas, le président de la République est amené à décider de tout. Et il porte la responsabilité de tout. Ce système devient profondément malsain.
Entretien avec Mme Anne Dujin et M. Raphaël Pinault.
